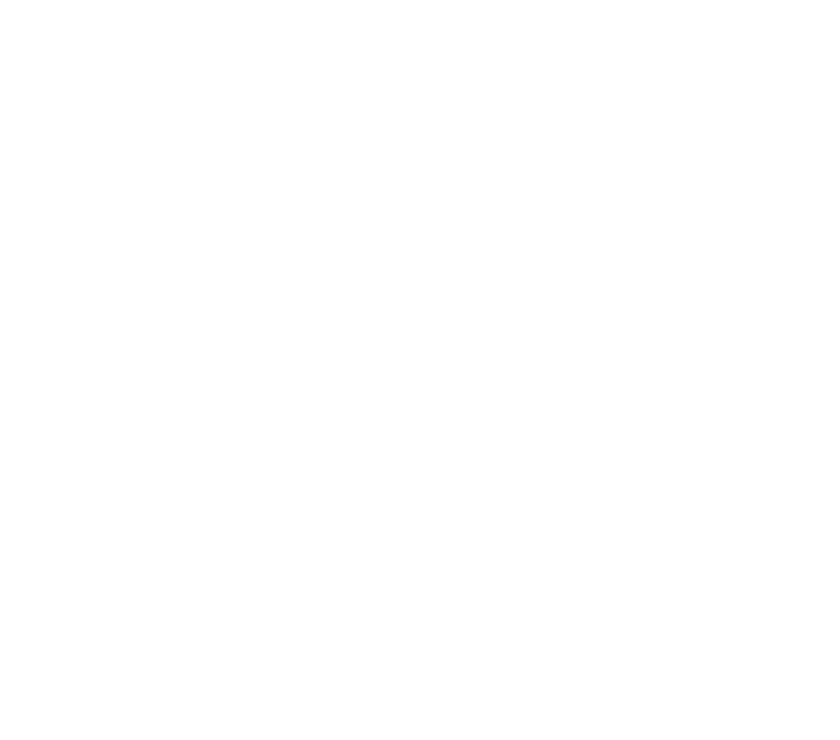Par MICHEL CARON | ADMINISTRATEUR DU THINK TANK FRATERNITE
L’article de Jean Lacau Saint Guily consacré au désert médical doit retenir toute notre attention. Il est d’un intérêt majeur pour les dirigeants politiques et administratifs ainsi que pour les élus de notre pays. Il peut inspirer ceux qui s’efforcent de réfléchir au management de service public et s’intéressent au devenir de la politique de santé publique et de ses métiers. Il est éclairant pour les perspectives actuelles de la relation des personnels soignants et des patients, appelés aussi bénéficiaires dans le secteur médico-social et du travail social en général, dans une séquence historique marquée par le vieillissement de la population. Faut-il rappeler en effet que déjà en 2021 1/4 de la population française avait plus de 60 ans et qu’en 2060, ce sera 1 personne sur 3 qui aura plus de 60 ans (Insee – Tableau de l’économie française).
La santé publique ne relève-t-elle pas d’une politique d’intérêt général ? La récente crise COVID nous a même enseigné qu’elle pouvait être prioritaire par rapport à l’activité économique, ce qui est inédit.
Qu’est-il donc arrivé pour que l’on parle de « déserts médicaux » ?
Loin d’être une figure de style ou une incitation au voyage, il s’agit bel et bien de la difficulté grandissante de nos concitoyens à accéder aux soins.
Pour répondre à la question, le bon sens nous pousserait à imaginer que l’on a oublié d’arroser quelque part, autrement dit, que l’exercice de la médecine et de la chirurgie sont très inégalement répartis sur notre territoire au regard des besoins et des lieux de vie de nos compatriotes.
L’auteur de l’article cité montre en effet comment la conception hospitalo-centrée de la politique de santé, alliée avec la marchandisation et la logique industrielle viennent bouleverser les métiers de la santé, jusqu’à remettre en question le sens même que les professionnels attribuent à leur métier.
Jean Lacau Saint Guily a raison de souligner que prendre soin d’un patient ne se réduit pas « à sa technologie et à des prestations segmentées, soumises à une succession de process d’optimisation industrielle » ; et l’augmentation des rémunérations ne répond pas à la hauteur du sens et de la valeur que les professionnels attribuent à leur métier. Certains le quittent, tandis que d’autres se satisfont de la recherche du profit.
À l’évidence, le secteur de la médecine est l’objet de la recherche d’économies d’échelle et de réduction de main-d’œuvre, ce qui fait dire à l’auteur que « la logique industrielle prend le pas sur tout ».
La rationalisation des taches et des organisations, inspirée par un fordisme d’un autre siècle, s’abat sur les métiers de la santé, avec pour conséquences la dépersonnalisation des relations de travail à l’hôpital et la recherche de la rentabilité dans la considération des patients. L’hôpital public, déjà fortement ébranlé par la crise COVID, n’y résistera pas et les inégalités d’accès aux soins se creuseront pour nos concitoyens les plus vulnérables.
C’est Daniel Cohen, qui, de son point de vue d’économiste, évoquait lui aussi « l’industrialisation des services » (1). Il ajoutait au tableau les effets de la révolution numérique, en prévenant : « En ligne, tout est fait pour réduire le coût de se divertir, S’éduquer, se soigner, ou se faire la cour… ».
Si les grands gagnants de la crise COVID ont été Amazon, Apple et Netflix, la possibilité de télétravailler s’est développée et la télé médecine a connu un développement, considérant que la relation médecin/patient ne nécessitait pas systématiquement la présence physique du patient au cabinet médical. De plus, « le besoin de se rencontrer en face à face avec ses collègues ou ses clients, est devenu une option parmi d’autres » (2). Et c’est précisément cette révolution numérique qui va servir de levier à des gains de productivité. Mais c’est à la fois le patient et l’organisation hospitalière qui sont « taylorisés » ; et ce sont nos compatriotes les plus vulnérables du fait de leur maladie, de leur isolement Social, de leur relégation territoriale qui subiront en premier les effets de la crise de l’hôpital et de l’existence des déserts médicaux.
La pertinence et l’actualité de l’article de Jean Lacau Saint Guily mérite également d’être éclairée par d’autres travaux de recherche que je veux signaler ici.
Il s’agit de la thèse de doctorat d’Hélène Van Compernol intitulée : Triptyque du sens du métier – Un essai de conceptualisation – Explorations et analyses d’incohérences de sens dans les métiers du « care ».
Je reprends ici le texte de présentation de cette recherche qui part du constat que les métiers évoluent non seulement » au rythme des évolutions sociales, sociétales et démographiques « mais aussi aux contraintes des évolutions et des innovations technologiques et organisationnelles, ainsi qu’aux « prescriptions et règlementations édictées par les autorités politiques. Dans le champ du travail social où l’identité des métiers se structure principalement autour de l’éthique du « care », le virage amorcé depuis le début des années 1980 et guidé par les principes de la Nouvelle Gestion Publique (NGP) tend à bouleverser les enjeux et finalités de l’action publique et du métier.
Aussi, plus encore que d’affecter les conditions de travail et les pratiques professionnelles, en prescrivant de nouveaux référentiels d’activité, les réformes de la NGP sont fréquemment décrites et considérées comme contraires à l’éthique et aux valeurs que les professionnels du « care », se font de leur métier, et contraires, in fine, au sens même de leurs métiers.
Dès lors, au regard de ces éléments contextuels et repères conceptuels qui les traversent, ce travail de thèse initie une réflexion et propose une conceptualisation du « sens du métier » articulée autour d’un triptyque dimensionnel conjuguant valeurs personnelles, représentation du métier et Représentation de la prescription. La recherche porte précisément sur le cas des éducateurs de jeunes enfants et l’introduction d’une réforme gestionnaire (la prestation de service unique) : « trois études empiriques viennent explorer les rapports de congruences et d’incongruences entre les valeurs qui sous-tendent l’agir Professionnel des EJE, la représentation sociale de leur métier, et la manière dont ces professionnels perçoivent et éprouvent la prestation de service unique. »
Pour ma part, j’ai engagé un travail intitulé dans un rapport d’étape « De la vulnérabilité à la solidarité », qui rejoint largement les travaux cités précédemment ,en faisant porter mon attention sur les multiples formes de vulnérabilité et sur les publics qui en cumulent bien souvent plusieurs ; une réflexion sur la solidarité, sur l’éthique du « care » et ses métiers, me conduit à approfondir la question d’une politique de la vulnérabilité ainsi que le rôle de l’économie sociale et solidaire, par rapport aux dérives de la marchandisation et de l’industrialisation des « métiers de l’humain » du secteur sanitaire et social.
Faut-il rappeler que ces métiers connaissent une grave crise de recrutement de professionnels et une tension sociale résultant des multiples facteurs évoqués plus haut. Je formule ici une alerte majeure concernant les métiers de la protection de l’enfance et ceux relatifs à l’accueil des personnes âgées et en perte d’autonomie.
Je veux dire que Jean Lacau fait œuvre d’utilité et d’intelligence par un article très éclairant sur l’avenir de tous ces professionnels qui doivent prendre soin de nous.
(1) Daniel Cohen-2022-Homo numéricus-P.70 à 73.
(2) Daniel Cohen – 2024- Une brève histoire de l’économie-P.112.
MICHEL CARON | ADMINISTRATEUR DU THINK TANK FRATERNITE
Le 2 décembre 2024